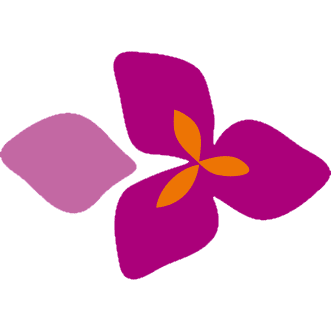Le Care à l’épreuve du Covid-19
Le concept du care naît aux Etats-Unis dans le livre In a different voice de Carole Gilligan (1985). Constatant que les critères de prise de décision morale diffèrent entre hommes et femmes (les uns se référant plus au droit et au calcul, les femmes s’orientant plus vers la relation et les interactions sociales), Gilligan établit un nouveau paradigme nommé care qui apparaît ensuite en Europe dans le champ social et éducatif. Il se définit comme « capacité à prendre soin d’autrui », « souci prioritaire des rapports avec autrui ».
Par care, nous entendons : « prendre soin en tant que « disposition psychique, attention tournée vers autrui » et « prendre soin par le biais d’une action concrète dirigée vers l’autre », deux dimensions inséparables se caractérisant par l’association de l’acte de soin avec la dimension émotionnelle vécue par le professionnel dans la relation à l’autre. Le care comporte aussi une dimension interactive, car l’attention portée à l’autre s’entend du professionnel vers le bébé, mais considère aussi la capacité précoce du bébé à prêter attention à nous ce qui provoque des émotions chez l’accueillant.
Le care naît alors que la psychologie s’introduit dans les EAJE dans les années 1980, s’appuyant, entre autres, sur les travaux de Winnicott, Spitz ou Dolto. En 1984, Bernard Martinot démontre au grand public que le bébé à une vie psychique et pointe l’importance du jeu. Le documentaire Le bébé est une personne marque cette période et une transformation des pratiques au sein des crèches commence, associant une dimension psychologique, affective et sociale aux soins donnés. Ainsi se fait une mue lente et laborieuse pour que « le soin prodigué à l’enfant » laisse place « au prendre soin » du jeune enfant. Les pratiques en crèche recherchent alors un consensus avec la définition de l’OMS définissant la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Avant la pandémie, bien qu’il y ait eu de réelles évolutions, la question éducative n’allait pas encore de soi. Laurence Rameau souligne que : « Lorsque l’on demande aux professionnels de définir ce qu’ils font réellement, ils mettent en avant la mission sanitaire de leur travail (veiller au bon développement et à la bonne santé de l’enfant), en ajoutant plus ou moins des axes éducatifs et, au mieux, créer la représentation d’un prendre soin éducatif qui donne une cohérence à leur travail. »
Au regard de la composition des équipes et de la législation des EAJE en France, la tendance sanitaire est une tendance qui tend à s’accentuer aujourd’hui avec le Covid-19. Les normes sanitaires ont envahi le quotidien des professionnels et donc celui des enfants et des familles. Les actes de désinfection réguliers occupent une place importante comme le signifie Odile, EJE en crèche collective : « Depuis le début de la pandémie, je ne peux plus faire mon travail d’éducatrice. Je passe tout mon temps à osciller entre la désinfection des jouets et le remplacement de mes collègues auxiliaires de puériculture, car entre les cas contacts entraînant des arrêts de travail, l’arrêt de la scolarisation des enfants et les cas positifs, nous sommes en sous-effectif chronique. Inutile de dire que l’éducatif n’est plus de mise et que le temps passé à prodiguer les soins aux jeunes enfants est réduit à peau de chagrin. » La lutte contre le Covid-19 supplante donc ici le projet éducatif.
Clairement, la crise du Covid-19 et ses mesures préventives modifient beaucoup le quotidien des crèches. La liste des mesures est longue et beaucoup sont chronophages (désinfection fréquente du matériel de base, du mobilier, des jouets, des mains des adultes et des enfants). L’organisation de l’espace doit aussi favoriser la distanciation sociale entre enfants à une période de leur vie ancrée dans le stade oral où la sphère buccale et œsophagienne est très investie et sert d’étayage à l’exploration du monde. Or, l’exécution de ces mesures préventives empiète sur le temps consacré directement à l’accompagnement éducatif. L’inquiétude des professionnels face aux risques sanitaires du Covid-19, envahit leur pensée et impacte leur disponibilité psychique et physique, troublant leurs compétences à exercer la fonction contenante nécessaire aux enfants.
Le virus a aussi entraîné une inquiétude du côté du contact entre les professionnels et fait voler en éclats le travail en équipe si nécessaire à la construction des pratiques éducatives et du prendre soin des enfants. Ainsi, ceux-ci restent dans leur espace de vie. Les temps d’échanges intergroupes ont disparu, car propices à la contagion. Le contact entre humains est devenu une source de danger et le corps est connoté de ce risque majeur de transmission de la maladie.
Lors d’une session de formation continue se déroulant au mois de juin 2021 à Paris, sur « le positionnement professionnel de l’éducateur de jeunes enfants en EAJE », les stagiaires ont beaucoup évoqué l’impasse où se trouve la question éducative en EAJE depuis le début de la pandémie. Il est même question d’un repli des professionnels sur eux-mêmes, car les protocoles prévoient d’éviter au maximum les déplacements d’adultes au sein de l’établissement et même sur les temps de pause, les contacts entre professionnels sont « empêchés » ou « limités » par l’organisation des mesures barrières.
Face à l’inquiétude générée par un virus mal connu, les adultes mettent en place des mouvements défensifs pour se protéger psychiquement d’un envahissement par l’angoisse.
L’intellectualisation et les obsessions phobiques avec craintes irrationnelles de contamination caractérisent le fonctionnement obsessionnel. Or, aujourd’hui, les professionnels doivent mettre en place des rituels de décontamination « obsessionnels ». Ceux-ci contribuent certes à lutter contre angoisses dépressives et sentiments d’impuissance bien réels ressentis dans ce climat de pandémie, mais peuvent s’avérer inefficaces si l’angoisse est trop forte. Rester touché par les émotions de l’enfant est donc souvent difficile pour les professionnels.
Dans une étude menée lors du premier déconfinement par M.-H. Hurtig (puéricultrice) et M.-P. Thollon-Behar (psychologue) sur 43 crèches en France, en Belgique et au Luxembourg, elles constatent que, si certains lieux avaient pour consigne d’éviter le portage surtout face à face, les professionnels disaient : « Il est impossible de ne pas répondre aux besoins de proximité physique des enfants accueillis. » L’injonction de limiter le portage les plaçait donc dans un conflit entre valeur professionnelle et autorité. En dépit des diverses injonctions ministérielles, les réactions des professionnels ont montré que la proximité professionnel/enfant/parents qu’elle s’entende comme proximité physique ou relationnelle était pour eux une valeur essentielle.